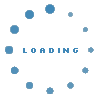La femme dans les religions (1)
Quand Dieu était une femme
Figure cosmogonique et symbole universel de fécondité, la « grande déesse » aurait fait l'objet, chez les peuples préhistoriques, d'un culte célébrant la terre nourricière.
"La religion de la déesse a existé bien plus longtemps que le christianisme, et laissé une empreinte indélébile sur la psyché humaine", écrit en 1990 l'archéologue américaine Marija Gimbutas. Selon elle, les Vénus paléolithiques et les idoles néolithiques sont des images de la "grande mère", figure cosmogonique et symbole universel de fécondité, qui se retrouve dans toute l'Europe jusqu'à l'âge du bronze : ces sociétés, dont les religions sont, selon elle, fondées sur le culte de la "grande déesse", auraient connu des formes de transmission matrilinéaire et de pouvoir matriarcal. Les mythes, les symboles et les structures sociales liés au culte et au règne de la "grande mère" auraient laissé non seulement des traces archéologiques, mais aussi des "survivances" dans notre psychisme, nos traditions et nos légendes.
L'idée d'un culte de la "grande déesse" qui aurait régné sur les premières civilisations humaines se fonde en effet sur l'existence d'une grande abondance d'images féminines peintes, gravées, de figurines de pierre, d'argile modelée ou de terre cuite, que l'on retrouve du rivage atlantique jusqu'à la Russie, au Moyen-Orient et dans tout le pourtour méditerranéen, du début du paléolithique supérieur, il y a plus de 30 000 ans, jusqu'à la fin du néolithique, il y a moins de 3 000 ans. L'absence de visage, l'extrême stylisation des formes et l'insistance sur les parties du corps en rapport avec la génération ont suscité l'idée que ces représentations féminines étaient en rapport avec un culte de la fertilité incarné par une "grande déesse", qui aurait perduré depuis le lointain des temps paléolithiques.
L'idée d'une religion préhistorique de la déesse s'associe à celle d'un culte de la fécondité chez les premiers peuples, qui s'adonnent à la culture du sol et à l'élevage d'animaux domestiques. Dans ces premières populations sédentaires et agricoles, la femme symbolise la capacité d'engendrer la vie, semblable à celle de la terre fertile et nourricière qui produit les moissons. De la propriété de la terre aurait découlé, avec l'intérêt pour la fécondité de la femme, une nouvelle valeur accordée aux enfants, à qui peuvent être transmis les biens et les fruits du travail de la terre.
Des figurines schématiques
C'est à partir du Proche-Orient et de l'Asie mineure qu'aurait pénétré la "religion de la déesse" dans tout le monde occidental. Les sites de la haute vallée du Jourdain, en Israël, voient apparaître, il y a 10 000 ans, avec les débuts de l'agriculture, des figurines féminines schématiques en calcaire, qui renouvellent l'iconographie jusque-là essentiellement animalière. Quelques siècles plus tard, le site de Mureybet, en Syrie, livre huit figurines en terre cuite : sur la plupart d'entre elles, le sexe et les seins sont indiqués. À ces images féminines, s'associent les signes d'une prééminence accordée au taureau, sous la forme de crânes enterrés avec leurs cornes dans des "banquettes d'argile" incluses dans les habitations. « Ce que nous voyons poindre pour la première fois au Levant autour de 9 500 avant notre ère, sont ces deux figures dominantes, la femme et le taureau, qui conserveront la vedette durant tout le néolithique et l'âge du bronze orientaux, y compris dans la religion de la Méditerranée orientale préhellénique », écrit le préhistorien Jacques Cauvin. L'émergence de ces images participe, selon lui, d'un bouleversement des cadres de pensée et des modes de vie qui caractérisent le processus de néolithisation au Proche-Orient. Le culte de la grande déesse serait ainsi la pierre angulaire d'un nouvel ordre des choses et du monde.
Cette association de la femme et du taureau se retrouve dans les sites néolithiques du plateau anatolien, en Turquie centrale. Les localités de Çatal Huyük et de Hacilar, datés entre 7 200 et 5 000 avant notre ère, révèlent une civilisation sédentaire déjà complexe, avec des habitations, dont les murs sont ornés de fresques associant des figures stylisées de femmes, bras et jambes écartés, semblant accoucher d'un taureau qui se trouve représenté sous elles. Dans les années 1960, l'archéologue anglais James Mellaart interprète ces habitations comme des temples voués à la déesse, dont le taureau représente le fils ou l'époux. Il y lit d'un côté des thèmes communs avec les thématiques de l'art du paléolithique supérieur, de l'autre côté les fondements d'une civilisation qui, née en Anatolie quelque 7 000 ans avant notre ère, se perpétue jusque dans la culture minoenne, mycénienne et la Grèce classique. Selon lui, les statuettes anatoliennes anticipent Athéna, Artemis et Perséphone, qui sont dans la Grèce antique les déesses de la terre et de la fécondité, maîtresses des animaux sauvages, régnant sur la vie et sur la mort. Ainsi, l'art, la religion et l'économie de Çatal Huyük devaient former le berceau de la civilisation occidentale, qui allait bientôt se répandre dans toute l'Europe.
New Age et féminisme
Ce thème d'une religion féminine qui se serait perpétuée jusqu'à l'aube des temps chrétiens a été récemment popularisé par le succès mondial du roman Da Vinci Code. Mais il se pourrait bien qu'un tel succès en dise autant sur les mutations actuelles de nos sociétés et sur les besoins de spiritualité de nos contemporains que sur les croyances préhistoriques. Portées jusqu'à la fin du XXe siècle par le renouveau du New Age et par l'essor du féminisme américain, ces interprétations ont connu un grand succès, mais elles restent, pour certains scientifiques, fragiles par l'universalité qu'elles postulent et par leur méthode de déchiffrement. Aujourd'hui, elles sont même abandonnées par une partie des féministes : cautionner la thèse de la déesse préhistorique, n'est-ce pas pérenniser en la divinisant l'image éternelle de la femme définie par sa passivité et sa fécondité, laissant au héros mâle le privilège de l'individualité et de l'action ? C.C.
Claudine Cohen
Philosophe et historienne des sciences, elle a notamment publié La femme des origines. Images de la femme dans la préhistoire occidentale (Belin-Herscher, 2006) et L'Homme des origines, savoirs et fictions en préhistoire (Seuil, 1999).
La revanche des dieux mâles
Naissance de l'agriculture et de l'élevage, sédentarisation et urbanisation des populations : la « révolution néolithique » initie une nouvelle donné. L'homme est désormais exalté en tant que reproducteur, guerrier et chef suprême de la cité.
Pour comprendre la masculinisation progressive des cultes, on peut essayer de remonter le temps à partir des religions actuelles. Celles-ci témoignent d'une domination du masculin dans la ou les personnes divines. Le dieu de la Bible (Adonaï, Elohim) est incontestablement masculin, même si le prophète Isaïe compare l'amour de Dieu à celui d'une mère (Isaïe 49, 15). Le dieu des chrétiens est père ou fils, jamais mère ou fille. Le dieu des musulmans (Allah) est masculin : l'islam est une « religion virile », selon Malek Chebel, et les fameux « versets sataniques » du Coran (sourate 53, 21-22) concernent trois divinités féminines, dont l'évocation blasphématoire valut à Salman Rushdie une condamnation à mort. Le monothéisme est donc masculin mais le dieu des Juifs, des chrétiens et des musulmans n'a pas de relations sexuelles, même si le dieu des chrétiens engendre (Jésus) mystérieusement.
Le dieu de la Bible est le rival de divinités sémitiques appelées Baal, au fort pouvoir sexuel. Son rival El (le nom Elohim en est dérivé) a aussi une grande puissance virile, comme l'atteste le poème des dieux gracieux et beaux d'Ougarit (Syrie) : « Et le membre d'El s'allongera comme la mer et le membre d'El s'allongera comme le flot. » Si le dieu monothéiste est à la fois uniquement masculin et entièrement désexualisé, les dieux antérieurs sont fortement sexualisés et s'accouplent avec des déesses : ils doivent donc partager avec elles leurs attributions. La sexualité humaine ou divine est une limite à l'action et un partage des pouvoirs, et il n'y a de dieu unique et tout-puissant que débarrassé de l'exigence de se choisir une « moitié ».
Cette exigence est au contraire au cœur du panthéon hindouiste, où chaque divinité a sa parèdre, une épouse qui lui donne son énergie (shakti). Shiva a pour femme Parvati et Vishnou Lakhsmi. Mieux, on vénère le phallus (linga) de Shiva et la vulve (yoni) de son complément féminin. En somme, les dieux de l'Inde sont mâles et mariés, alors que le dieu d'Abraham est masculin et sans épouse, même si, dans la foi populaire, la Vierge Marie a été élevée au rang de quasi déesse.
Une "révolution des symboles"
Peut-on remonter au-delà dans le temps et tenter de trouver les origines de ces dieux mâles ? Si la préhistoire a, dès le paléolithique, ses symboles masculins (phallus en érection, « bâton de commandement »), on n'a pas retrouvé de statuettes masculines symétriques des « déesses mères » aux traits féminins et maternels accentués. Quand et comment cette prédominance du féminin a-t-elle décliné ? En raison du grand nombre de fouilles archéologiques, de la présence de très anciennes écritures et de l'ancienneté de la « révolution néolithique », le Proche-Orient semble la région du monde la mieux à même de fournir des éléments de réponse partiels.
La naissance de l'agriculture et de l'élevage paraît avoir apporté ce que le préhistorien Jacques Cauvin appelle une «révolution des symboles» et une "naissance des divinités" plurielles et sexuées. Le taureau est ici privilégié, comme dans d'autres aires culturelles : en Inde, il sera plus tard la monture de Shiva, et en Grèce, l'un des symboles de Zeus. La pratique de l'élevage semble avoir exalté le rôle du mâle reproducteur. Ce culte du taureau machique paraît avoir décliné progressivement au point qu'au début de l'ère chrétienne, le culte de la déesse Cybèle comporte des sacrifices de taureaux pratiqués par des prêtres eunuques. La divinisation de certains clergés, prototype du célibat sacerdotal ou monastique, a d'ailleurs certaines connexions avec l'expansion du christianisme en des lieux comme Éphèse (ville dédiée à la chaste Artémis) ou Athènes (la cité de la vierge Athéna).
Mais entre le début du néolithique et l'aube de l'ère chrétienne, les dieux mâles ont bénéficié, surtout à partir du IIIe millénaire avant notre ère, d'importantes innovations techniques et politiques. La culture par irrigation a permis un accroissement de population et une urbanisation donnant naissance à des cités-États puis à des États. La figure du roi prêtre mésopotamien ou du pharaon égyptien est masculine, et la hiérarchisation des sociétés a engendré des panthéons à dominante masculine. Puisque la hiérarchie est le pouvoir (arché) sacré (hiéros), les dominations divine et humaine se correspondent dans un culte de l'autorité très peu féminin : Mardouk à Babylone, Amon-Rê en Égypte, Zeus en Grèce et Jupiter à Rome sont des divinités masculines.
Combat et concurrence virile
À la même époque, l'usage des métaux (bronze, fer) pour le combat favorise l'émergence de dieux guerriers, tandis que les métaux précieux (or, argent) suscitent une concurrence virile pour la possession de trésors répartis entre les palais et les temples. Les femmes étant peu présentes dans cette compétition physique, celle-ci est symbolisée par des dieux souvent musclés (selon la statuaire), tels Mars à Rome ou Arès en Grèce. Néanmoins, d'anciennes déesses mères, telle Ishtar à Babylone, conservent un statut de protectrices des guerriers, comme Athéna en Grèce ou, bien plus tard, Notre-Dame-des-Victoires dans le catholicisme. La revanche des dieux mâles n'a donc jamais été complète dans l'Antiquité proche-orientale puis gréco-romaine. O.V.
Odon Vallet
Historien des religions et spécialiste d'anthropologie religieuse, il est l'auteur de Les Religions dans le monde (Flammarion, 2003) et de Dieu et le village planétaire (Bayard, 2008).
La misogynie dans les textes
Dans nombre de traditions religieuses, divers écrits tentent de montrer le caractère inférieur de la femme. Une constante : le dénigrement de son corps et de son esprit.
Si la revanche des dieux mâles n'a pas été complète dans l'Antiquité proche-orientale puis gréco-romaine, la domination masculine s'impose dans les grandes traditions historiques, même celles sans image sexuée de l'absolu (bouddhisme, taoïsme) ou révérant des déesses puissantes (hindouisme). Basée sur le dénigrement du corps ou de l'esprit des femmes, cette domination utilise parfois un outil encore plus redoutable : l'oubli pur et simple.
Dans l'Ancien Testament, Ève apparaît comme responsable de la Chute : « L'origine de l'erreur est la femme et nous mourrons tous par sa faute » (Siracide 25, 24). Au fil des siècles, les traditions chrétienne puis musulmane s'appliquent chacune à démontrer que la femme est déficiente. L'étude des textes est édifiante : la misogynie est bel et bien inscrite dans la Bible et le Coran. Si elle est moins présente dans les textes hindouistes et bouddhistes, elle n'en demeure pas moins très forte dans la pratique. Un parti pris de départ, que la tradition ne cessera d'aggraver, au lieu de le corriger, malgré les évolutions sociales récentes, généralement dues à la séparation des diverses Églises et de l'État.
• Un « corps second »
Pour les Juifs et les chrétiens, la femme est « un corps second ». Dans la Genèse, après avoir créé l'homme, Dieu déclare : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui » (Gen 2, 18). Après l'avoir plongé dans le sommeil, il façonne une de ses côtes pour créer la femme. Celle-ci est donc vue d'emblée comme une servante sans image dans les cieux et « Dieu » comme un masculin. Paul renchérit : « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme ; et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme » (1Cor 11, 7-11). Ou encore :« Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ; car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église qui est son corps » (Éphésiens 5, 22). On ne saurait mieux dire que l'homme doit être un dieu pour elle.
La première version du récit de la création (la Genèse), écrite avant la victoire du patriarcat, dit pourtant : « Dieu créa l'humanité [littéralement a adama, « une créature de terre »] à son image, mâle [zakar] et femelle [nekava] il les créa » (Gen 1, 27). L'humanité est alors double et Dieu contient l'image des deux sexes, mais cette version égalitaire a été oubliée. Seule la seconde fut commentée par les Pères de l'Église, qui sont, semble-t-il, passés peu à peu de l'idée de « corps second » à celle de corps raté, puis à celle de corps monstrueux, voire satanique.
• Le corps d'un « homme raté »
Pour Thomas d'Aquin, mort en 1274, la femme correspond « au second dessein de la nature, de même que la putréfaction, la difformité et la décrépitude » (Summa Theologiae q 52a 1ad 2). Plus question ici d'une aide « semblable à lui ». Fort de conceptions médicales fantaisistes, Albert le Grand, mort en 1280, déclare de son côté : « La femme est moins qualifiée que l'homme pour la morale. Car la femme contient plus de liquide, et c'est une caractéristique des liquides d'absorber facilement, mais de mal retenir. (...) La femme est un homme raté, par rapport à l'homme, elle ne possède qu'une nature défectueuse et imparfaite. (...) Aussi doit-on en résumé se garder de chaque femme comme d'un serpent venimeux ou du diable cornu... Son sentiment pousse la femme vers ce qui est mauvais, de même que sa raison entraîne l'homme vers ce qui est bon » (Quaestiones super de animalibus XV, q 11). Pour Clément d'Alexandrie, qui vécut au IIIe siècle, « la conscience même de leur nature ne doit évoquer en elles qu'un sentiment de honte » (Paedagogus II, 33, 2).
Ainsi, la plupart des Pères de l'Église sont convaincus qu'au paradis, la femme se résorbera dans le masculin, toujours pensé comme un neutre. La reproduction n'ayant plus de sens, elle perdra ses organes, mais l'homme restera inchangé. Le fait que le corps féminin n'existe que pour enfanter (des garçons si possible) est affiché par Augustin (354-430). Ayant inventé le concept des « limbes » dans lesquels sombrent, selon lui, les nouveaux-nés non-baptisés, il recommande de sacrifier la mère en cas d'accouchement difficile. La femme, sans valeur intrinsèque, n'est qu'un rouage procréateur. De nombreux bouddhistes estiment, eux aussi, que le corps féminin ne permet pas d'atteindre l'Éveil. Au VIIIe siècle, Shantideva inclut cette prière dans La Marche vers l'Éveil : « Que tous les êtres féminins arrivent au sexe masculin ! » (chapitre X, verset 30).
• Un corps pollué et sali par les règles et la naissance
Dans les religions du Livre, les règles sont impures et viennent de la malédiction ayant frappé Ève. Les lois juives sont les plus sévères : pendant ses règles, la femme est nidda (exclue). Il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec elle ou même de la toucher. Avant de reprendre une vie normale, elle doit subir un bain purificateur (avec la tête immergée). Dans l'islam et le christianisme, seules les relations sexuelles demeurent interdites. Saint Jérôme déclare vers l'an 400 : « Quand un homme a des rapports avec sa femme pendant cette période, il lui naît des enfants lépreux ou hydrocéphales ; souillés par ce sang impur, les corps des deux sexes deviennent soit trop gros soit trop petits » (Commentaires sur Ezéchiel, 18, 6). Jusqu'au Moyen Âge, les hommes d'Église débattront pour savoir si une femme peut entrer à l'Église pendant ses règles ou communier.
Le bouddhisme reflète la même terreur masculine : selon le sutra du bol de sang, les femmes stériles ou mortes en couches tombent dans un étang formé par l'accumulation du sang menstruel, qui symbolise leur souillure. En Orient comme en Occident, les lois religieuses déclareront que les femmes doivent être écartées de toute fonction liturgique (ou autre) en raison de leur sang menstruel.
Dans le judaïsme, les accouchées aussi sont impures. La Vierge se rend ainsi à Jérusalem, quarante jours après la naissance de Jésus, pour faire une offrande purificatrice. Dans le christianisme, le synode de Trèves, en 1227, parle d'une nécessaire « réconciliation avec l'Église ». Chez les catholiques, la cérémonie des relevailles a parfois persisté jusque dans les années 1960. Les femmes mortes en couches ne sont pas mieux traitées. Ainsi que le mentionne Luther outré, en 1530, chez les « papistes », elles ne peuvent pas être enterrées dans la partie commune du cimetière.
• Un corps passif lors de la reproduction
Pour les religions du Livre, la femme n'est qu'un vase (passif) dans lequel l'homme (actif) verse sa semence. Et la découverte de l'ovule ne suffira pas à changer des millénaires de représentations erronées. La femme donne à l'embryon sa chair, mais l'homme lui confère l'esprit. La reproduction qui aurait pu être la grande gloire de la femme lui est ainsi retirée. Elle n'est qu'un four incubateur qui, s'il fonctionne bien, produit des garçons, et quand il a des ratés, produit des filles. À la naissance des enfants, l'homme peut s'enorgueillir, mais la femme qui s'est contentée de le seconder doit se purifier pour être entrée dans la sphère dangereuse où l'être et le non-être se côtoient.
Dans le bouddhisme et l'hindouisme, dont le but est d'échapper à la ronde infernale des vies successives (le samsara), donner la vie semble souvent négatif : par la faute de la femme, la roue continue à tourner. Certains courants de ces religions peuvent haïr le corps et fuir la reproduction. Similairement, dans le christianisme, Paul - et après lui de nombreux millénaristes -, persuadé que la fin du monde est proche, déclare qu'il serait néfaste de continuer à se reproduire. Les femmes sont ici considérées comme une menace.
• Un corps dangereux car sexué
Dans le christianisme, la femme est une tentatrice. À elle seule, elle est « le sexe ». Pour Augustin, le péché originel a été l'acte de chair et se transmet de génération en génération par la sexualité. La femme est l'agent du péché, sauf si l'acte sexuel a pour seul but la procréation. Pour Thomas d'Aquin, « rien ne fait chuter l'esprit de l'homme de son élévation autant que les caresses de la femme et le contact physique sans lequel il ne peut posséder son épouse » (Sth II/II q151a 3ad 2). Le plaisir étant satanique, les Pères de l'Église feront tout pour l'empêcher, en codifiant l'acte sexuel dans tous ses détails, en l'interdisant les trois quarts de l'année (pour cause de fête religieuse), et même en célébrant la frigidité. La misogynie patristique est portée à sa conclusion logique par deux dominicains, Krämer et Sprenger, qui inventent l'archétype de la sorcière, en 1487, dans Le Marteau des sorcières (et non des sorciers). Quand on leur demande pourquoi Satan s'en prend plutôt au sexe qu'à la nourriture, ils répondent, dans la droite ligne d'Augustin, que « depuis la Chute, la sexualité est plus proche du diable »...celle de la femme s'entend. La méfiance initiée par Paul - « je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme » (1 Cor 7